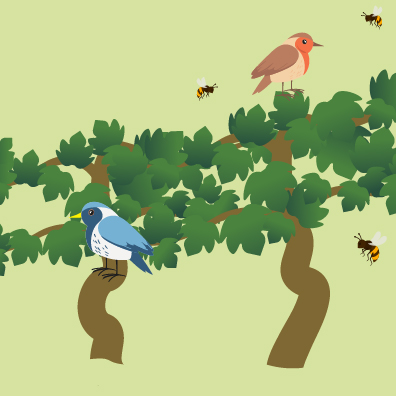
Un entretien avec Jean Foyer, chargé de recherche CNRS en anthropologie.
Pendant plusieurs années, Jean Foyer a conduit une étude dans sa région d’origine, auprès de vignerons d’Anjou engagés en biodynamie. Au fil de ses entretiens et rencontres (relatés notamment dans son ouvrage Les Êtres de la vigne), il découvre une attention particulière au vivant, au sensible, mais aussi une ouverture à l’expérimentation. Des approches qui ouvrent le champ des possibles et nourrissent la viticulture bio dans son ensemble.
Qu’est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la viticulture biodynamique comme objet de recherche ?
– Ce qui m’intéressait en premier lieu, c’était la culture de la vigne avec ses rapports aux savoirs et à la nature. Avant cette étude, je ne buvais pas de vin ! L’intérêt pour le vin n’est venu que dans un second temps quand je me suis rendu compte que les vins reflétaient très souvent les démarches et la personnalité des vignerons. On peut vraiment parler de vins d’auteur, de la même manière qu’il y a des films d’auteur. Ce ne sont pas les standards attendus par le marché, mais des vins qui se distinguent, souvent faits par des personnalités originales. On ne boit pas un simple chenin de Loire, on boit “un Bruno Rochard” !

Comment analysez-vous le lien entre viticulture bio et biodynamie ?
– Le bio est un socle commun : pour être en biodynamie, il faut d’abord être certifié en bio, puis on peut pousser une certaine démarche un peu plus loin avec la biodynamie. La frontière entre viticulture bio et biodynamie est perméable. D’un point de vue historique et politique, les biodynamistes ont toujours accompagné le mouvement bio. Mais, au-delà des cahiers des charges, c’est finalement la cohabitation de toute une gamme de rapport à la nature, au vivant, aux savoirs, en fonction des personnes, des trajectoires de vie, de la structure de l’équipe… Tous les vignerons en biodynamie partagent néanmoins un point commun : ils questionnent en permanence leurs pratiques.
Qu’est-ce qui vous a marqué dans ces pratiques, que vous avez observées de près ?
– Passer du conventionnel en bio et à la biodynamie, c’est se réapproprier ses méthodes de travail, c’est faire confiance à son intuition. Plutôt que de s’appuyer sur les béquilles de la chimie de synthèse, c’est apprendre à utiliser ses sens comme des indicateurs. Cela implique de passer beaucoup de temps dans ses vignes, d’observer, d’utiliser tout ce qui est jugé bon pour le domaine, pour les vignerons eux-mêmes, pour leurs vignes. Cela invite à renforcer l’observation sensible du monde, être attentif, à se faire confiance, et à expérimenter surtout, dans une volonté de réexplorer et de revalider certains savoirs paysans, sans forcément revenir aux pratiques d’antan.
« Beaucoup d’innovations diffusées en bio sont nées des expérimentations en biodynamie. »
Justement, quelle place tient cette expérimentation ?
– Le critère de validation, c’est l’expérience et la pratique : “Je sais parce que je l’ai fait des tonnes de fois”. En ce sens, les vignerons deviennent des expérimentateurs de plein air ! Ici, c’est plutôt l’innovation par retrait, le retrait de béquille techniques et chimiques. Chaque domaine devient un laboratoire. On n’est pas dans l’expérience scientifique, car chaque paramètre est ici incontrôlable : l’ensoleillement, la pluie, la température, etc. Beaucoup d’innovations diffusées en bio sont nées de ces expérimentations : l’enherbement, la sélection à la ferme, l’utilisation de compost ou de purins… L’ancien président de l’Institut technique de l’agriculture biologiques (ITAB), Thierry Mercier, me disait que les chercheurs étaient de plus en plus attentifs à ce que proposaient les biodynamistes d’un point de vue technique. En ce sens, la biodynamie est un des principaux laboratoires de l’expérimentation de techniques bio !




