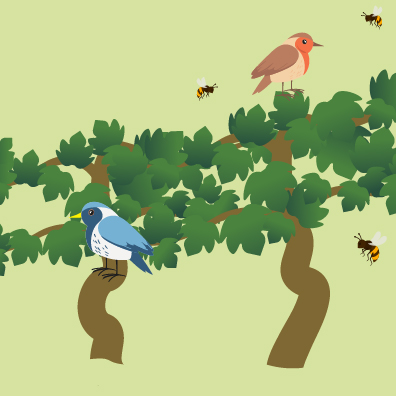
Un entretien avec Éric L’Helgoualch, conseiller en biodiversité auprès des groupes des agriculteurs et de vignerons et animateur de la Fresque de la biodiversité.
Depuis plus de vingt ans, Éric L’Helgoualch accompagne agriculteurs et vignerons dans leurs pratiques pour enrichir la biodiversité au sein de leurs cultures. Au-delà de l’abandon des pesticides de synthèse en viticulture bio, l’enjeu est aussi de repenser la structure paysagère pour favoriser la présence d’une flore et d’une faune qui, en retour, participeront à la protection des vignes.
En quoi les cultures impactent-elles la biodiversité ?
– Les intrants chimiques et les pratiques culturales insuffisamment raisonnées entraînent la dégradation et la contamination des habitats, qui deviennent moins favorables à la diversité des espèces qu’ils accueillent. Mais la structure du paysage joue aussi un rôle majeur. Par exemple, d’après les travaux de Michel Jay, pionnier des études sur les auxiliaires des cultures, une campagne bocagère peut accueillir environ 80 espèces d’oiseaux pour 100 km² ; ce chiffre chute de moitié lorsqu’on arrache les haies et on tombe à moins de 20 espèces dans les plaines agricoles intensives.
Dans les vignes, de quelle biodiversité parle-t-on ?
– ll existe plusieurs niveaux de biodiversité : la diversité génétique (au sein d’une même espèce, par exemple en viticulture, les clones ou la sélection massale), la diversité spécifique (le nombre d’espèces, les cépages en viticulture) et la diversité des écosystèmes qui est ce qui nous intéresse ici. On parle souvent en agriculture de diversité fonctionnelle, mais ce terme reflète une approche très anthropocentrée : à quoi la biodiversité va-t-elle nous servir ? Aujourd’hui, nous préférons parler d’“alliances avec le vivant”, entre humains et non-humains. Cela implique d’accepter de quitter le rapport de domination sur la nature, dans la lignée des réflexions de François Terrasson, de Philippe Descola ou de Baptiste Morizot.

Peut-on parler d’une prise de conscience qui modifie les pratiques culturales ?
– La viticulture bio entraîne forcément une réflexion sur la biodiversité : comment la favoriser pour une meilleure alliance avec la conduite du vignoble ? Longtemps, la logique a été de réduire la diversité dans les vignes pensant mieux maîtriser la production. L’herbe, les arbres, tout ce qui était perçu comme une “concurrence” était supprimé, on voulait des parcelles “propres”, nettes, jusque dans leur environnement immédiat pour parvenir au zéro bio-agresseur (insectes ravageurs et champignons, acariens) ! Cette logique était encouragée par les solutions « clé en main » comme les herbicides ou les puissants insecticides de synthèse. Résultat, le vignoble devenait moins résilient, avec des sols érodés et des bio-agresseurs difficiles à réguler. Aujourd’hui, il y a cette prise de conscience : il faut réintroduire d’autres espèces que la vigne pour recréer un milieu mieux équilibré.
« Aujourd’hui, nous préférons parler d’“alliances avec le vivant”, entre humains et non-humains. »
Justement, par quoi un vigneron peut commencer ?
– Une certaine maîtrise reste nécessaire, on ne peut pas se contenter de “laisser faire la nature” au risque de ne pas pouvoir récolter ! Un prérequis : réduire et adapter l’usage des intrants, la bio étant une belle solution. Mais inutile, par exemple, d’installer uniquement des nichoirs dans des vignes si aucune herbe ne pousse ou s’il n’y a pas d’arbres alentour, cela ne fonctionnera pas ! Il faut travailler sur le paysage, préserver sa diversité, le rendre plus complexe, plus fourni, avec des aménagements comme des bandes fleuries, des tournières et des rangs enherbés, des haies, des arbres, des talus végétalisés… pour proposer des habitats et un milieu d’accueil favorable à la faune. Et au-delà de la biodiversité, cela enrichit aussi le paysage. Dans l’imaginaire, ce qui est beau est bon, un paysage harmonieux est souvent associé à un vin de qualité.

L’efficacité de la faune auxiliaire a-t-elle été prouvée ?
– Oui, au-delà des insectes étudiés (micro-hyménoptères, chrysopes, syrphes…), les oiseaux et chauve-souris sont des acteurs du service éco-systémique de régulation dont l’efficacité est validée par les scientifiques. Par exemple, on montre que les chauves-souris jouent un rôle important dans la régulation des tordeuses de la grappe. De manière plus générale, c’est l’équilibre global de l’écosystème qui apporte la régulation. Aujourd’hui, des insectes (comme des petites guêpes) sont commercialisés pour lutter contre les vers de la grappe, comparables à l’usage d’un produit de contrôle.
Quels obstacles empêchent la généralisation de ces pratiques ?
– Il y a deux freins principaux. Le premier est le manque de rentabilité économique immédiate des techniques et des aménagements à mettre en place, les actions sur la biodiversité ne sont donc pas prioritaires. Par exemple, implanter des arbres dans le vignoble est un projet sur le long terme. Ceux qui s’y engagent sont généralement en situation de bonne valorisation de leurs vins. Désormais, les plantations en « agroforesterie » sont incluses dans les calculs de la superficie plantée, ce qui limite le manque à gagner pour le vigneron. Le second frein, et sûrement le plus important, est la résistance au changement, que l’on connait tous plus ou moins : planter alors que l’on arrachait, semer alors que l’on labourait, changer sa façon d’envisager la propreté du vignoble !




